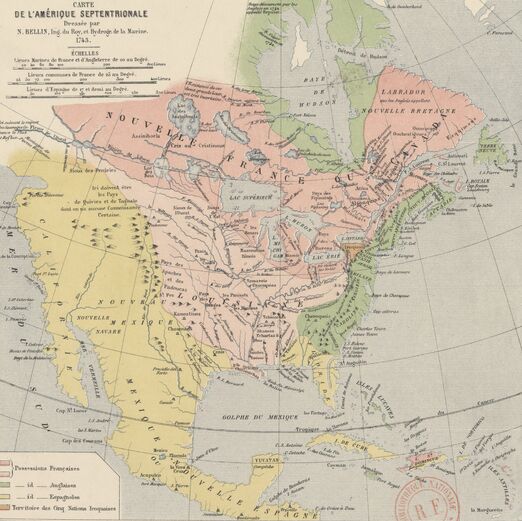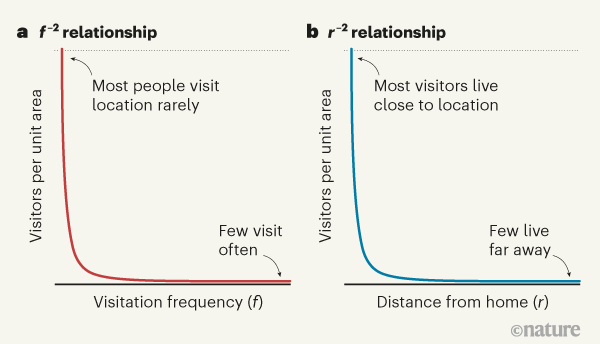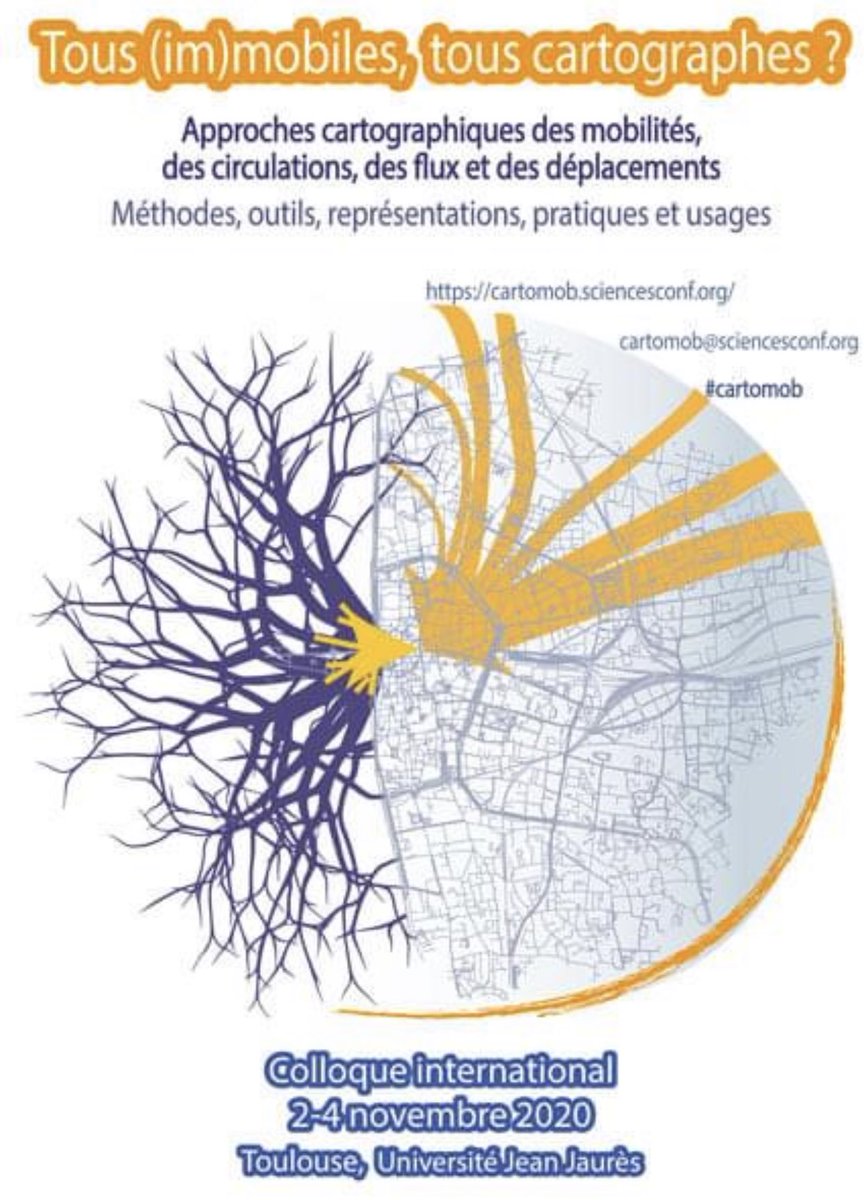7-18 octobre 2020 Mapathon
Concours de (géo)datavisualisation de données
Présentation Contributions
14-16 juin 2021 Manifestation scientifique.
Téléchargez le programme
Lundi 14 juin 2021
13:30
Ouverture du colloque
• Équipe de coordination de #Cartomob
• Xavier BERNIER, pour la Commission Géographie des Transports du Comité National Français de Géographie (CNFG)
• Corinne SIINO, pour l'équipe CIEU de l’UMR LISSTl'équipe CIEU de l’UMR LISST
• Christine ZANIN, pour la Commission Sémiologie du Comité Français de Cartographie (CFC)
14:00
Session Transports et Mobilités
• 14h – S. Genevois vidéo
De l’hypermobilité généralisée à l’immobilité contrainte : quels récits (carto)graphiques de nos mobilités, quotidiennes en temps de pandémie ?
• 14h30 – B. Mericskay vidéo
Représenter (carto)graphiquement les pratiques de covoiturage : explorations visuelles et réflexions méthodologiques autour des données des plateformes BlaBlaCar et Registre de Preuve de Covoiturage
• 15h – R. Vuillemot, P. Riviere, A. Tabard & A. Beignon vidéo
Conception d'une carte isochrone simplifiée pour visualiser l'accessibilité aux transports urbains
15h30 : Pause
• 15h45 – R. Kerbiriou & A. Serry vidéo
Les signaux AIS et la cartographie de la circulation maritime
• 16h15 – L. Merchez, M. Adam & H. Rivano vidéo
Cartographier la cyclabilité, enjeux méthodologiques et mises en débat autour du cas de Lyon
• 16h45 – J. Karlsron, J.-M. Favreau & G. Touya vidéo
Le carrefour dont vous êtes le héros
• 17h00 – N. Robinet vidéo
L’accessibilité aux alternatives des déplacements en voiture dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme en 2016
17h15 : Pause
• 17h30 – A. L’Hostis vidéo
Closer Cities and Distant Space: The Chinese Geographical Time-space by Air and Road
• 17h45 – A. Ottenheimer vidéo
Exploration des flux de déplacement domicile-travail en région Occitanie
• 18h00 – A. Cruz, C. López Escolano, S. Valdivieso Pardos & Á. Pueyo Campos vidéo
Affichage cartographique des informations géoréférencées d’un parc de véhicules urbains. Application à la ville de Zaragoza (Espagne)
Mardi 15 juin 2021
_______________________________________________________________________________
09h00 : Conférence
Olivier CLOCHARD : Cartographier les migrations : des expériences intimes aux politiques illégitimes vidéo
_______________________________________________________________________
9h45
Session Migrations et frontières
• 9h45 – D. Lagarde vidéo
Cartographier les récits de l’exil syrien. L’exemple des exilés de Deir Mqaren
• 10h15 – R. Kaedbey vidéo
Expérience de « cartographie des témoignages ». Les (im)mobilités révélées par les récits des Syriennes
et des Syriens
• 10h45 – M. Dujmovic vidéo
« Sans travail ou sans papiers : le dilemme d’Ahmed » : une fabrique cartographique à hauteur d'individu
11h : Pause
• 11h15 – M. Sanchez vidéo
Le rôle des mobilités dans la cartographie mentale de l’espace européen des migrants des nouveaux États membres
• 11h45 – D. Goeury & A. Delmas vidéo
Le SARS-CoV2, la frontiérisation aboutie du monde
12h : Pause déjeuner
13h00 - 14h45
Session Mobilités dans la ville
• 13h00 – M. Najman vidéo
Una mirada movil de la segregación urbana
• 13h30 – M. Boquet & N. Dorkel vidéo
Des piétons dans la ville : cartographie des itinéraires des chalands dans l’hypercentre commerçant de la ville de Metz
• 14h – M. Spor & A. Póvoas vidéo
Cartographier l’éthique. Les consommateurs mobiles entre choix et contrainte
• 14h30 – P. Guinard & F. Troin vidéo
Mobilités narratives des personnages de Mélo (Frédéric Ciriez, 2013) ou comment saisir les dimensions sensible, performative et identitaire des déplacements à partir d’une cartographie des parcours
14h45 : Pause
15h00 - 16h30
Session Tribute to Tobler
• F. Bahoken, É. Côme & N. Lambert vidéo
- Création et visualisation de champs vectoriels pour l’analyse de matrice Origine Destination
- Vers une relecture du Flowmapper
• A.-C. Bronner & G. Vuidel vidéo
La régression bidimensionnelle
16h30 - 18h00
Session Ateliers & démonstrations
• J. Vallée & A. Douet vidéo
Le Mobiliscope, une application geoweb des villes et de leur mixité sociale à toute heure selon les déplacements des individus
• F. Bahoken, É. Côme, L. Jégou & N. Roelandt vidéo
Arabesque, une application d’exploration et de visualisation thématique de flux dans le géoweb
• C. Richer & P. Palmier vidéo
Les « bassins de déplacements » au Cerema pour accompagner les Régions dans la définition des Bassins de Mobilité
Mercredi 16 juin 2021
_______________________________________________________________________________
09h00 : Conférence
Sara Irina FABRIKANT: Smart cartographic tools for wise navigation decisions
_______________________________________________________________________
9h45 - 10h45
Session Représentations : confrontation entre anciennes et nouvelles formes
• 9h45 – A. Hecker vidéo
Cartographier pour appréhender les mobilités d’hier
• 10h15 – A. L’Hostis vidéo
Quelle est la forme de l’espace-temps géographique ? Un modèle tridimensionnel fait de courbes et de cônes
10h45 : Pause
• 11h00 – J. Varlet vidéo
Graphique et mobilité. Simplifier les visualisations pour comprendre et décider
• 12h00 – V. Moura de Lacerda Teixeira & J-F. Bacrot vidéo
Les outils collaboratifs comme méthodologie pour l’analyse de phénomènes urbains liés à la mobilité des villes moyennes brésiliennes : la fragmentation sociospatiale à Ituiutaba et Presidente Prudente
12h : Pause déjeuner
13h30
Sessions Expositions (virtuelles) Images de mobilités
• 13h30 – D. Lagarde, pour le Collectif GéoCompostelle vidéo
Sur les chemins de Compostelle
• 14h00 – N. Lambert, pour le Collectif Migreurop vidéo
Expériences migratoires
• 14h30 – J. Dupont, pour KartoKobri vidéo
Un atlas transconfinemental
15h00
Table ronde conclusive : Cartographie et Mobilités aujourd'hui ? vidéo