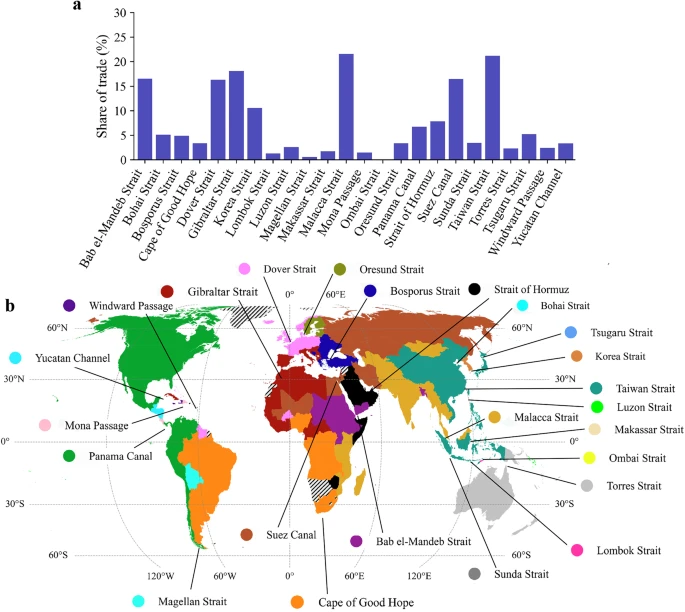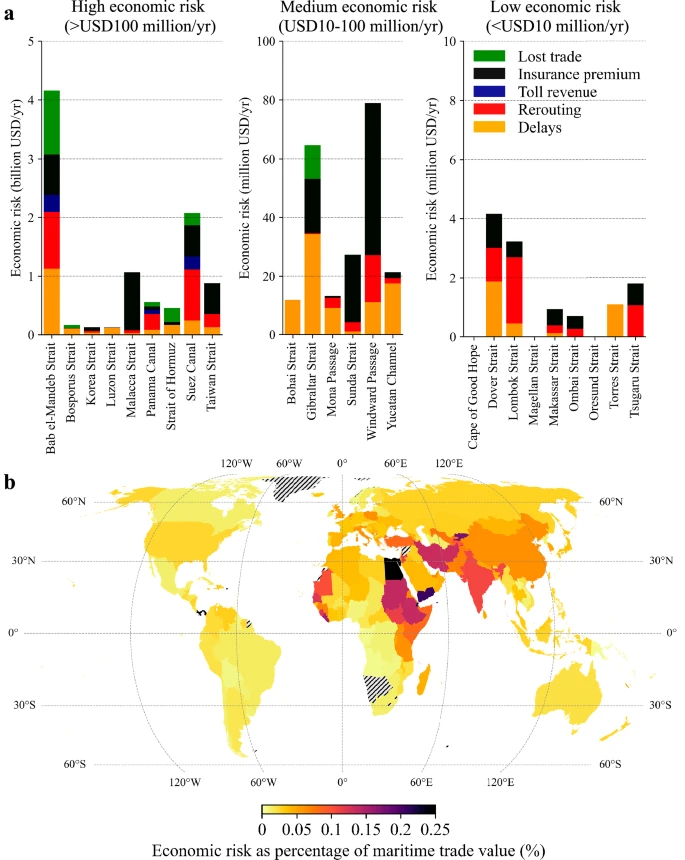Source : « En 2025, le solde naturel en France est négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » (Bilan démographique 2025 - Insee Première)
La démographe Hélène Thélot présente le bilan démographique 2025 de la France. L’étude analyse naissances, décès, migrations et structures par âge. Elle montre une rupture historique. Pour la première fois depuis 1945, le solde naturel devient négatif. Au 1er janvier 2026, la France compte 69,1 millions d’habitants, soit +0,25% en un an. Cette croissance ne vient plus des naissances mais du solde migratoire, estimé à +176 000 personnes en 2025. Depuis 2010, les naissances ont chuté de 23,6%. Cette baisse ne vient pas du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants, mais du recul durable de la fécondité. L’indicateur conjoncturel de fécondité descend à 1,56 enfant par femme. C’est un niveau inédit depuis la Première Guerre mondiale. La baisse touche surtout les 25-34 ans. L’âge moyen à la naissance atteint 31,2 ans pour les femmes et 34,1 ans pour les hommes. Les décès augmentent de 1,5% en 2025 et atteignent 651 000. Cette hausse s’explique par une grippe hivernale sévère, mais surtout par l’arrivée des générations du baby-boom à des âges de forte mortalité.

Les projections évoquent jusqu’à 800 000 décès annuels vers 2040. L’espérance de vie progresse encore légèrement. Elle atteint 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes. L’écart entre les sexes se réduit. Ce vieillissement par le haut modifie profondément les équilibres démographiques et sociaux du territoire français. En 2026, les 65 ans ou plus représentent 22,2% de la population, presque autant que les moins de 20 ans, à 22,5%. En 2006, ces parts étaient très différentes. La France entre dans une phase de vieillissement accéléré, comparable à celle observée dans le reste de l’UE. Le bilan montre une transition démographique achevée. La France rejoint la majorité des pays européens au solde naturel négatif. Vieillissement, baisse durable de la fécondité et rôle central des migrations redessinent les dynamiques territoriales, économiques et sociales à long terme.
Traitement du sujet dans les médias
« Population, naissances, espérance de vie : carte d’identité de la France en trois graphiques » (La Tribune).
"Ce qui frappe, c’est à quel point, en quelques années, le solde naturel a diminué en raison de la diminution rapide des naissances », a relevé Sylvie Le Minez, cheffe de l’unité des études démographiques et sociales de l’Insee. On remarque, en parallèle, une tendance haussière concernant les décès, du fait de l’arrivée à des âges de forte mortalité des générations nombreuses du baby-boom (les personnes nées entre 1945 et 1975)".
« La France a enregistré plus de décès que de naissances en 2025, une première depuis la fin de la seconde guerre mondiale » (Le Monde).
"Cette nouvelle donne ouvre des perspectives qui dépassent les seules considérations démographiques ; elle pose la question du financement de la dépendance et des métiers du care, peu valorisés mais essentiels dans l’accompagnement des personnes âgées, interroge les décisions à court et moyen termes en matière de politique familiale et d’emploi, et appelle enfin à assumer des choix concernant le recours à l’immigration, dans un marché européen à cet égard concurrentiel".
« Plus de décès que de naissances : 2025, l'année du grand basculement démographique » (
Les Echos).
"La tendance amorcée au printemps 2025 où le solde naturel du pays avait basculé dans le rouge s'est donc confirmée. Ce qu'aucun démographe n'avait imaginé voir advenir si tôt. L'Insee anticipait un croisement des courbes des naissances et des décès en… 2035. L'évolution démographique du pays est devenue un sujet de préoccupation majeur pour la classe politique. « La fin programmée de la croissance démographique remet en question les fondements de notre modèle socio-économique », résume dans une interview aux « Echos » Pauline Rossi, prix du meilleur jeune économiste du « Monde » et du Cercle des économistes en 2023, qui publie ces jours-ci « Le Déclin démographique, une urgence économique ». Une mission d'information sur la baisse de la natalité a été créée à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe Horizons et Indépendants. La consultation citoyenne lancée dans la foulée a confirmé un fort attachement à la parentalité des Français. Mais les jeunes adultes ne souhaitent plus avoir autant d'enfants que dans le passé. Selon une étude récente de l'Institut national d'études démographiques (Ined), le nombre idéal à leurs yeux est désormais de 2,3, contre 2,7 en 1998. De plus, l'arrivée du premier enfant est de plus en plus tardive. «Le désir d'enfant reste élevé, mais la fécondité chute. Cela place la France dans une situation inédite », relève Jérémie Patrier-Leitus, le rapporteur de la mission. Une enquête de l'Union nationale des associations familiales (Unaf) présentée la semaine dernière montre que le manque de confiance dans l'avenir et le coût de l'enfant sont les deux premiers freins au projet familial. Les ruptures dans la politique familiale pèsent également. « Les politiques publiques doivent se donner comme but d'aider les gens à avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent », a plaidé Bernard Tranchand, le président de l'Unaf".
« Solde naturel négatif, 69 millions de Français, unions en hausse : les cinq chiffres à retenir du bilan démographique de l’Insee
» (Libération). "Si la baisse des naissances se poursuit, la population continue à augmenter légèrement. Avec une augmentation de 1,4%, les unions ont la forme. En 2025, l’Insee recense 251 000 mariages, dont 7 000 entre personnes de même sexe (2,9 % du total). En 2024, 197 000 pacs (pacte civil de solidarité) ont été enregistrés, dont 10 400 entre personnes de même sexe (5,6 %). Après un rebond de 2,7 % l’an dernier, les mariages continuent d’augmenter, avec + 1,4 % cette année. «On s’attendait à un rattrapage progressif par rapport aux années de pandémie, indique Sylvie Le Minez. Mais on s’aperçoit que ça va au-delà.» Depuis 2010, une baisse était observée tant du côté des mariages que pour les pacs. Un potentiel regain d’intérêt, notamment pour les mariages, que l’institut entend surveiller dans les années à venir."
« Le solde démographique négatif, une réalité qui gagne toute l’Union européenne » (
La Croix).
"Alors que la France a enregistré cette année plus de décès que de naissances, l’Union européenne connaît cette réalité depuis 2015, selon les chiffres compilés par Eurostat. Depuis 2020, le nombre de décès dans l’Europe des 27 dépasse même chaque année de plus d’un million celui des naissances. Selon les chiffres compilés par Eurostat, le solde naturel de l’Union européenne (Royaume-Uni compris jusqu’en 2020) est devenu négatif en 2015. Depuis 2020, le nombre de décès dans l’Europe des 27 est même devenu supérieur, chaque année, de plus d’un million à celui des naissances. La France est le dernier grand pays de l’UE à basculer en négatif. Depuis sa réunification en 1990, l’Allemagne a toujours connu moins de naissances que de décès, tandis que le solde naturel italien est passé en négatif en 1993, le solde polonais en 2013 et le solde espagnol en 2015, précise Eurostat. Selon les chiffres les plus récents d’Eurostat, en 2024, la France, l’Irlande, la Suède, Chypre, le Luxembourg et Malte étaient les seuls pays de l’Union à afficher un solde naturel positif, soit six pays sur 27. Le Danemark est lui à l’équilibre.Malgré un solde naturel négatif depuis une décennie, la population de l’Europe des 27 a continué à augmenter ces dernières années, tirée par un solde migratoire positif. Mais selon ses dernières projections publiées en 2023, l’Union européenne s’attendait, dans son scénario central, à atteindre un pic de population en 2026, avant d’entamer une lente décrue à partir de 2027."
Avec la baisse démographique, le nombre d’élèves continue de chuter en France : quel impact pour l’école ? (
Ouest-France).
"À l’école, cette baisse démographique est observée par l’Éducation nationale depuis de longues années. Les élèves sont de moins en moins nombreux, et les conséquences sont nombreuses pour les familles et les collectivités. « Nous connaissons une chute démographique massive, avec 150 000 élèves de moins attendus à la rentrée 2026, annonçait récemment le ministre Édouard Geffray dans Ouest-France . C’est considérable. Nous n’avons jamais été confrontés à une telle situation. » Ces dernières années, la France perdait en moyenne 100 000 élèves par an. Conséquence : entre 2015 et 2024, 3 000 écoles publiques ont été fermées, sur 47 400 comptabilisées à ce jour dans l’hexagone. Et à chaque annonce de la carte scolaire, qui redessine la répartition des classes à chaque rentrée au sein d’un département, parents et enseignants manifestent pour sauver leur établissement."
Pour compléter
« Les populations de référence des communes au 1er janvier 2023. La population française continue de croître, le solde naturel y contribue de moins en moins » (Insee Focus).
"Entre 2017 et 2023, les littoraux atlantique et méditerranéen continuent de gagner des habitants (figure 2a). Les métropoles régionales de Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Rennes connaissent une hausse annuelle de la population de leur aire d’attraction supérieure à 1 %. Inversement, une large diagonale allant du nord‑est au sud‑ouest concentre les baisses de population en raison d’un solde naturel très négatif, compensé par le solde migratoire apparent uniquement dans le sud du pays. Cinq communes de plus de 100 000 habitants connaissent une croissance annuelle supérieure à 1 % : en premier lieu Villeurbanne, puis Montpellier, Toulouse, Rouen et Rennes. Elles tirent leur croissance à la fois du solde naturel et du solde migratoire apparent. À l’opposé, les populations de Mulhouse et Paris ont les plus fortes diminutions relatives malgré un solde naturel favorable. Paris connaît ainsi la deuxième plus forte baisse de population, en pourcentage, parmi les communes de plus de 100 000 habitants. L’excédent des naissances sur les décès ne compense pas le déficit des départs sur les arrivées".
Taux d'évolution annuel moyen de la population entre 2017 et 2023 (source : Insee Focus)
Évolution de la population par tranches d'âge (Carte du mois - Novembre 2025, Région Nouvelle- Aquitaine, Direction de l'Intelligence Territoriale, de l'Evaluation et de la Prospective).
De nombreux territoires misent sur l'attractivité vis-à-vis des jeunes pour assurer leur développement futur. L'analyse par tranche d'âge des dynamiques démographiques proposée dans ce récit montre que beaucoup de paris seront perdus : si 41% des intercommunalités connaissent une baisse de la population, elles sont 79% à connaître une baisse de la catégorie des moins de 30 ans et encore 70% dans ce cas pour les 30-59 ans. La baisse tendancielle de la population que connaissent un nombre croissant de territoires s'accompagne donc d'une déformation importante de la structure par âge de tous les territoires, qui conduit à une baisse tendancielle bien plus générale des catégories d'âges jeunes. Ces évolutions sont lourdes de conséquences pour les territoires, car les besoins diffèrent en fonction de l'âge des habitants, que l'on parle éducation, santé, commerces, emploi, culture... Les ressources des collectivités, qui dépendent en partie du nombre d'habitants, sont également impactées. Documenter précisément les dynamiques à l'oeuvre pour chacun des territoires est donc indispensable pour mieux anticiper, et donc mieux préparer, l'avenir.
Articles connexes
Données de population par mailles de recensement d'1 km² (Eurostat)Le vieillissement de la population européenne et ses conséquencesBaisse de la part des jeunes dans la population de l’Union européenne d’ici 2050Territoires et transitions : enjeux démographiques (9e rapport de l’Observatoire des territoires, 2021-2022)