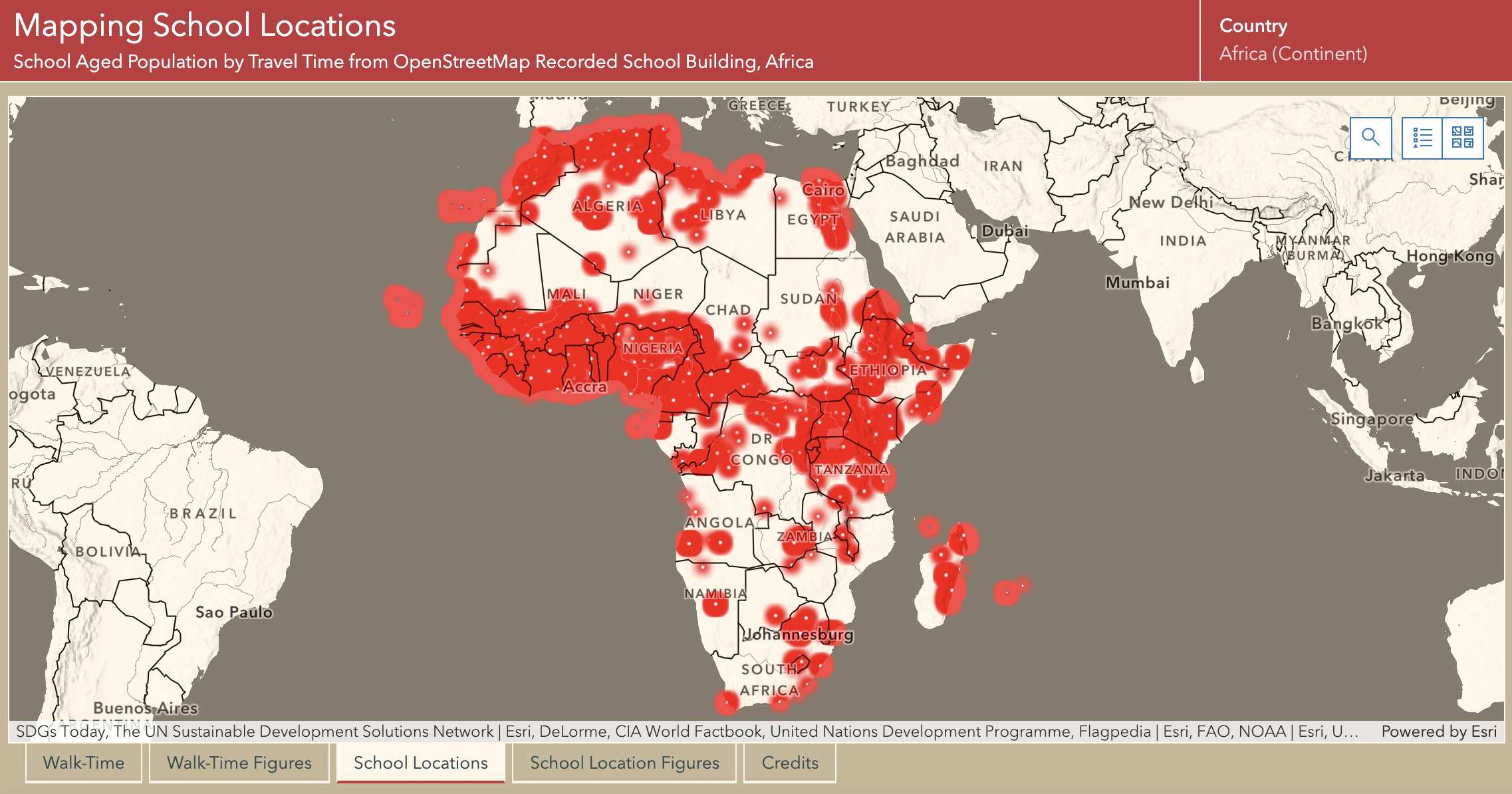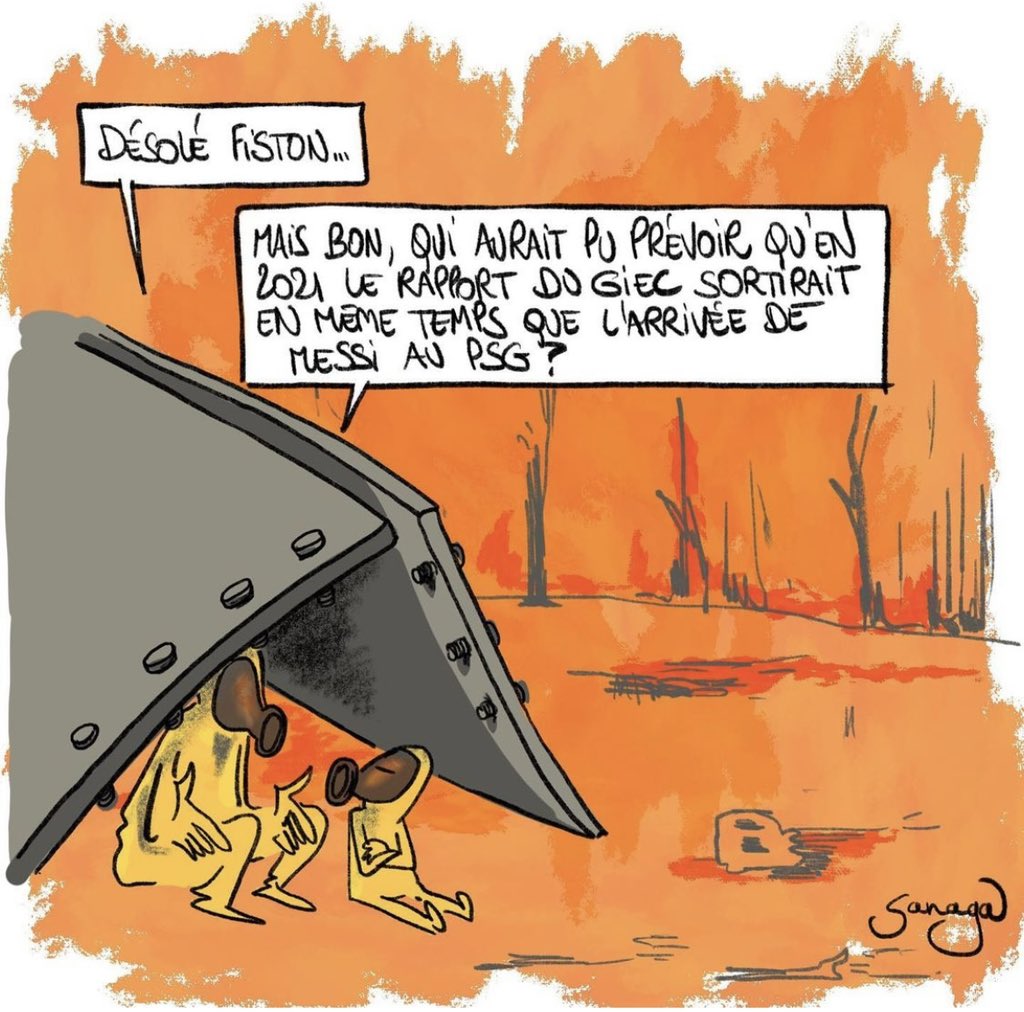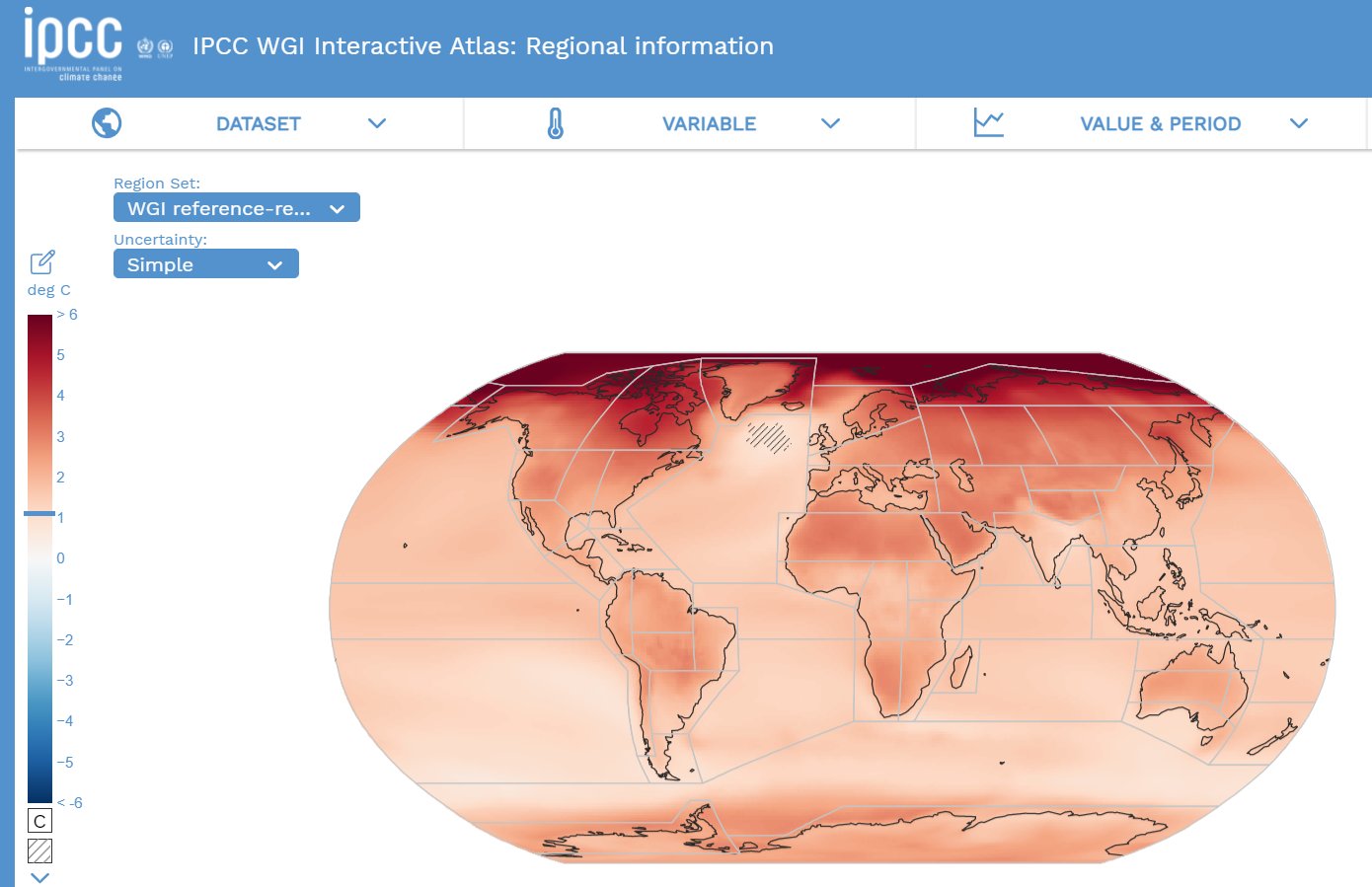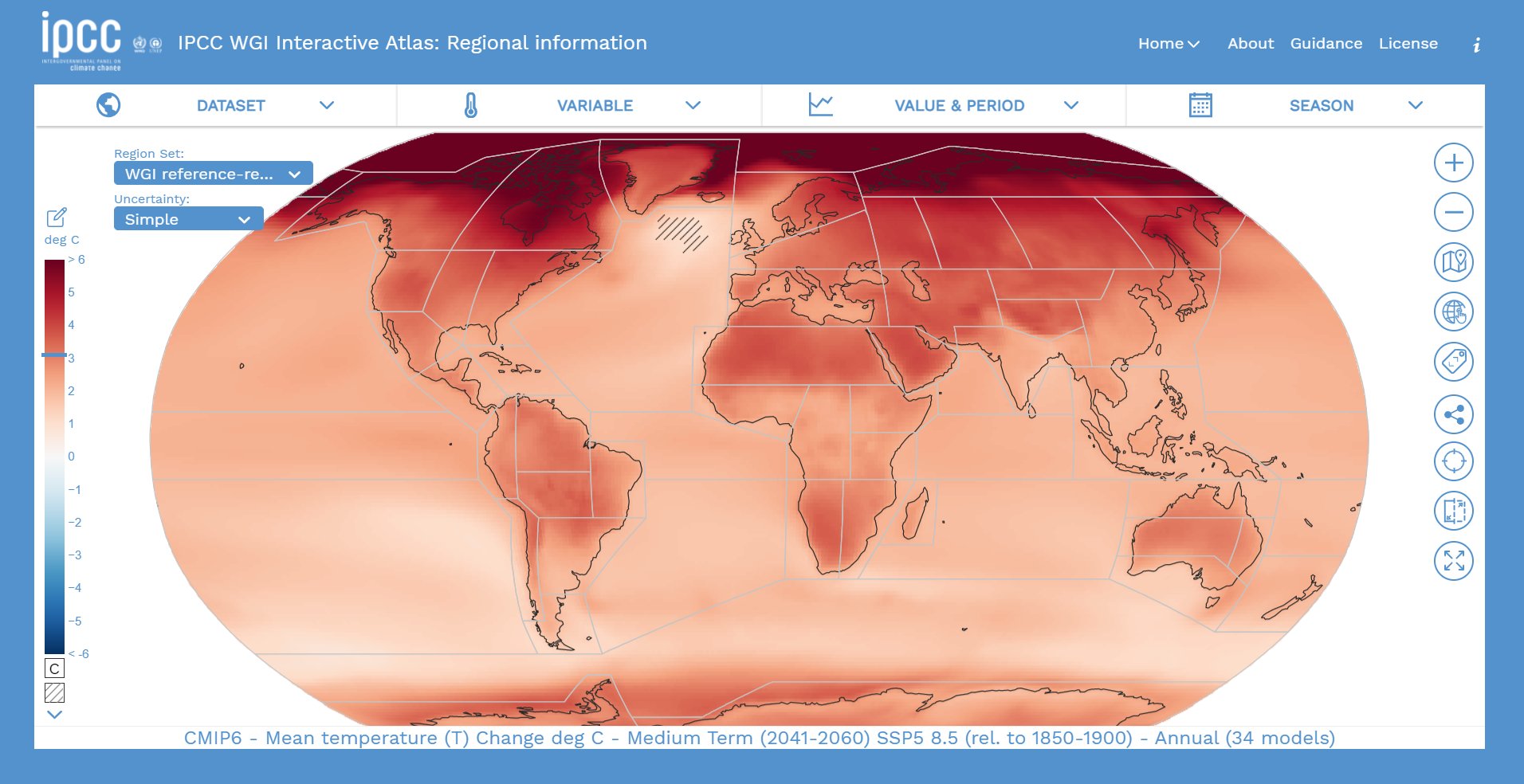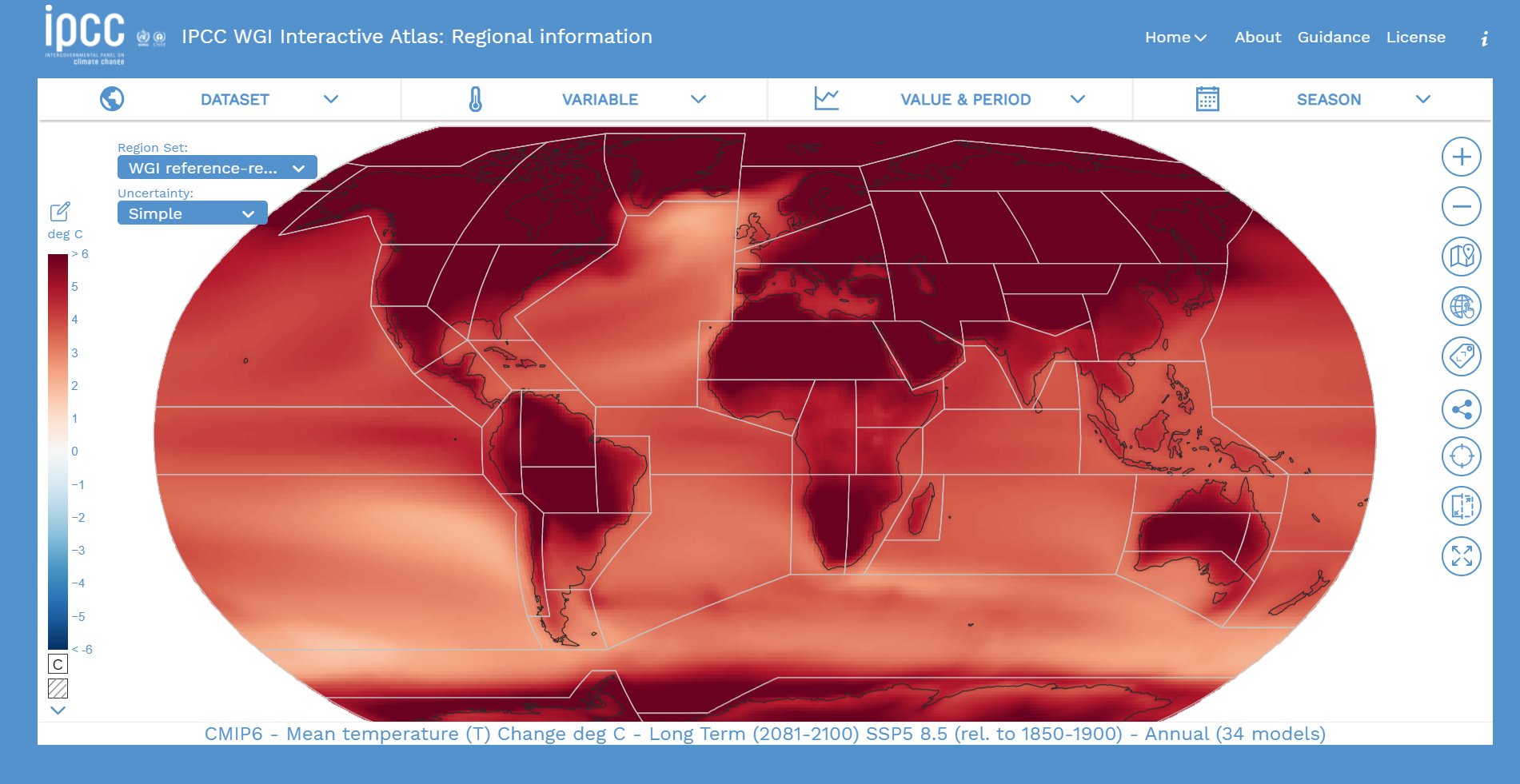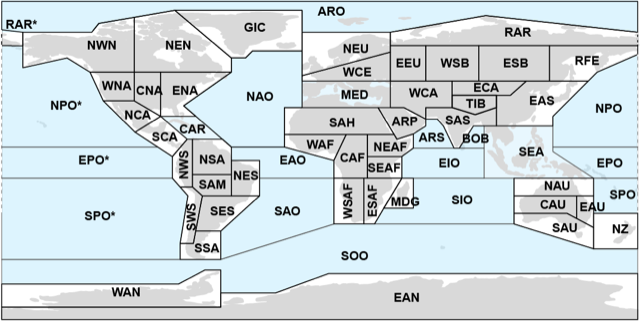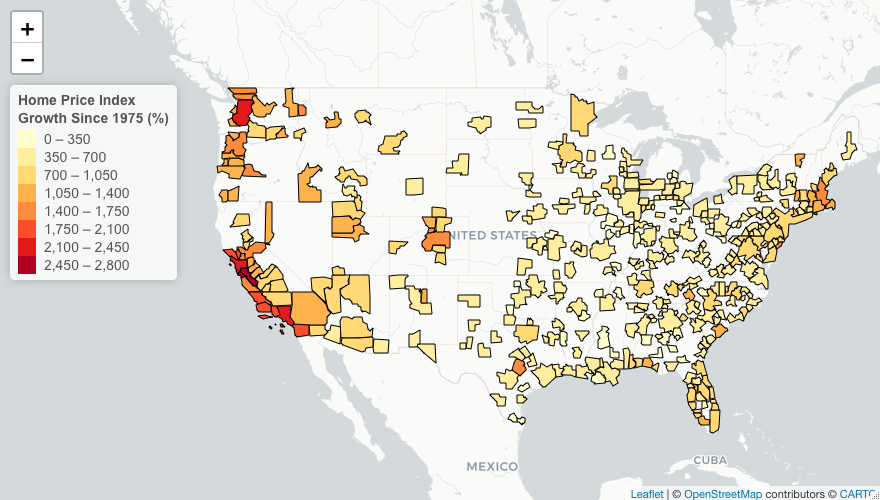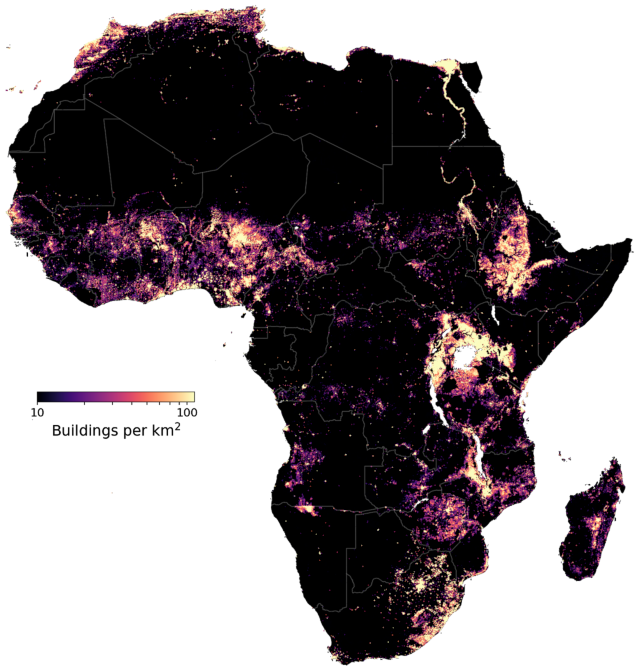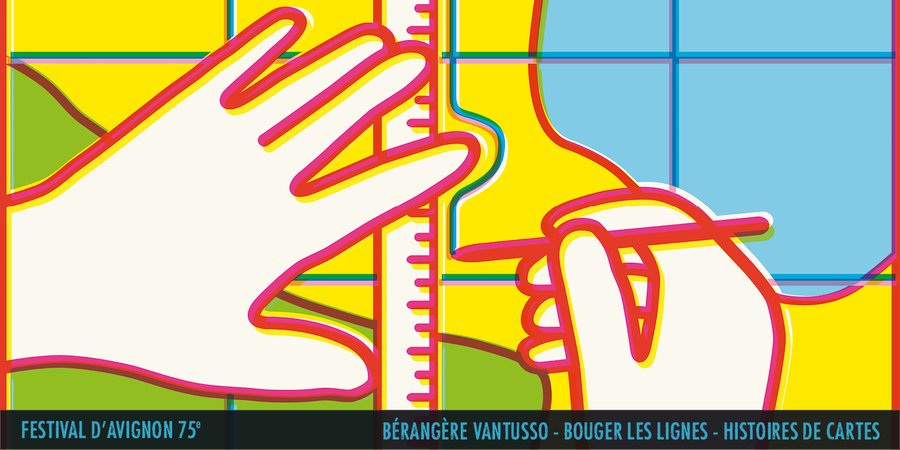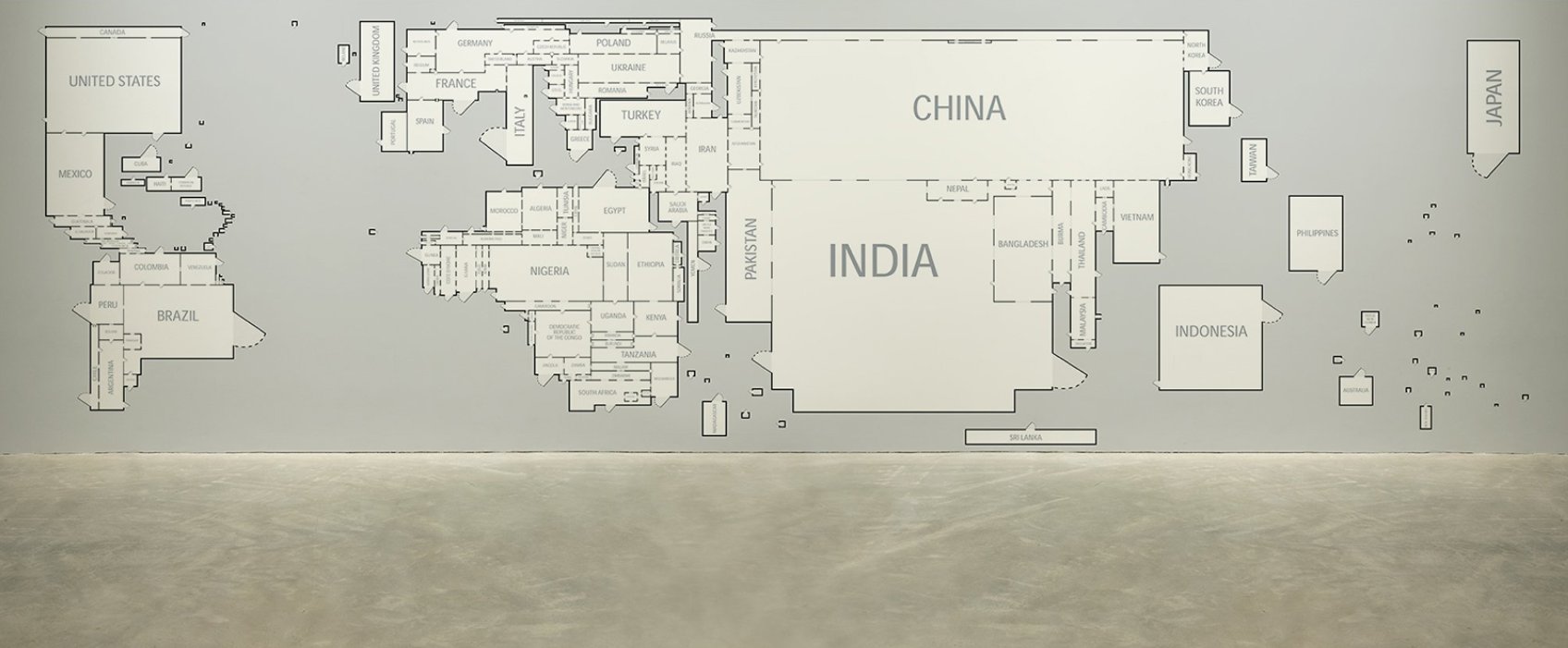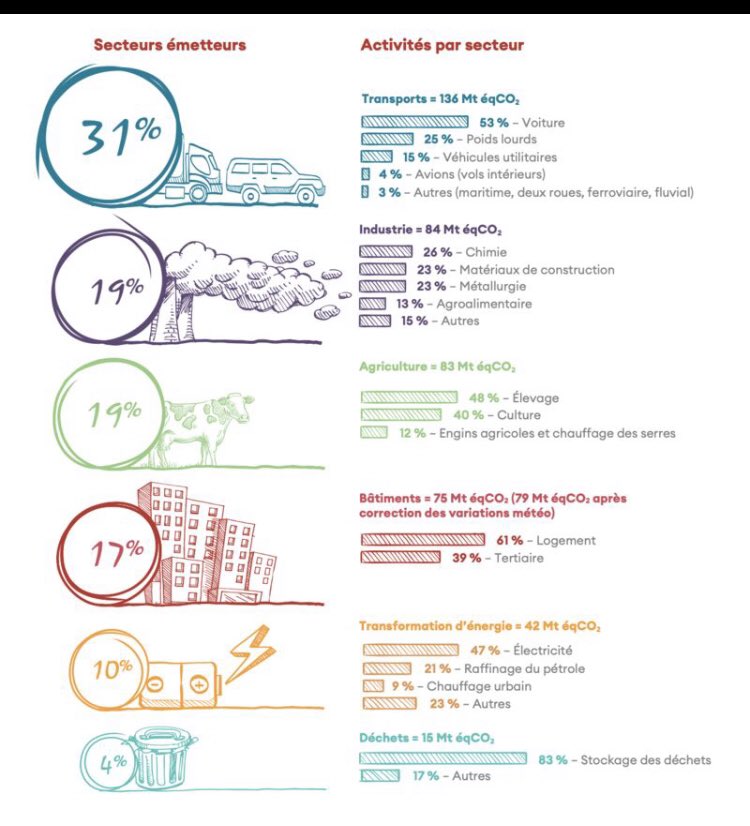D. Barba : Le GPS est il une carte comme les autres ?
Ch. Grataloup : Oui et non. Oui c'est une carte absolument comme les autres, souvent c'est la base IGN pour le territoire français. Mais le fait qu'on puisse zoomer, c'est-à-dire changer les échelles rapidement dans un sens ou dans l'autre, alors qu'avant il fallait changer de feuille de papier pour changer d'échelle. Et puis on avait des seuils, on ne pouvait pas prendre n'importe quelle échelle. D'autre part, le fait qu'on puisse continuer au-delà, qu'on n'a pas de bord si j'ose dire. C'est la révolution essentielle, il n'y a pas de limites. Oui parce que tout le problème pour le planisphère, c'est qu'on a des bords.
Jules Grandin : Je pense que le GPS, au final, c'est une carte comme les autres. On va dire la version la plus moderne de la cartographie qu'on puisse avoir, c'est-à-dire qu'on a toute la cartographie qui est accessible dans une toute petite boîte. C'est un peu le savoir cartographique condensé à l'extrême, si vous voulez pour moi.
D. Barba : Isabelle Joschke, vous disiez que vous n'utilisez plus de cartes papier en mer parce que ça va beaucoup trop vite et c'est compliqué de faire le point (c'est l'expression consacrée pour les navigateurs et navigatrices sur une carte papier). Est-ce que vous trouvez que c'est une évolution positive où est-ce que vous êtes un peu nostalgique, à titre personnel, de la carte en papier ?
Isabelle Joschke. Pour moi, c'est un peu les deux. J'avoue que la carte papier, ça avait vraiment un charme quand je préparais une course, lorsque j'avais encore des cartes papier. Cela racontait une histoire en fait. Aujourd'hui, tout est fait de manière très immédiate et quelque part j'ai juste le temps de regarder où je suis, d'utiliser ma cartographie comme un élément de sécurité. Mais j'aime bien regarder une carte et avoir le temps de voir où est passée ma route. Pour moi, ça fait vraiment rêver.
D. Barba : Je pense à la randonnée, notamment la carte en papier sert à ça, mesurer le chemin parcouru, c'est une histoire de fierté finalement. Alors évidemment, le papier est de plus en plus supplanté par les outils numériques. Mais vous, Isabelle Joschke, quand vous regardez une carte, une mappemonde, vous voyez les trajets que vous avez parcourus ?
Isabelle Joschke. Oui, je vois les trajets et pour moi la carte ça vient parler de ça : toutes les traces qu'on peut faire virtuellement sur les océans, sachant que sur un océan on ne voit rien que du bleu autour de soi. On peut traverser l'Atlantique de plein de manières possibles. Il y a toujours une route qui est plus rapide que les autres quand on fait de la course. Quelque part c'est la plus belle route avec la météo pour le moment-là et la carte, elle permet de rendre ça qui est très réel en fait.
D. Barba : Vous avez participé au dernier Vendée Globe. Est-ce que vous diriez que parmi les nombreuses compétences nécessaires pour s'imposer dans une course au large, il y a aussi la cartographie ? Est-ce que la victoire parfois tient en partie à cela ?
Isabelle Joschke : Une chose est sûr, c'est qu'il faut être capable de bien connaître sa carte, de bien savoir la lire et l'analyser. Si l'on fait une erreur, et j'en ai fait beaucoup parce que ça fait longtemps que je fais du bateau, ca finit mal, en l'occurrence c'est pour ça que je disais que c'est un élément de sécurité. En fait, quand on navigue près des côtes par exemple, la cartographie c'est ce qui nous permet d'être toujours à un endroit ou il y a suffisamment d'eau pour le bateau et pour la quille et de passer. C'est vraiment le premier truc de passer au bon endroit et du coup savoir lire la carte, c'est primordial en fait [...]
D. Barba : Les erreurs cartographiques, je sais Jules Grandin que c'est un sujet qui vous passionne.
Jules Grandin : Tout-à-fait. Les erreurs cartographiques, c'est quelques chose qui m'intéresse beaucoup. Généralement quand quelle que chose est cartographié, alors cela devient réalité pour les gens qui regardent la carte. S'il y a une erreur sur la carte, il va falloir aller sur le terrain pour prouver que c'est une erreur. A partir du moment où c'est mis sur la carte, ça revêt une sorte de réalité et il va falloir ensuite prouver que c'est faux, si jamais on en repère une.
D. Barba : Il y a de magnifiques épisodes d'erreurs dans l'histoire de la cartographie.
Jules Grandin : Tout-à-fait. C'est un peu ma marotte. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'île de la Californie. Pendant longtemps on représentait la Californie comme une île puisque les gens qui étaient allés jusque-là s'étaient trompé avec la péninsule de Basse-Californie qui est séparée du continent par un très gros bras de mer. Et du coup ils voyaient la Californie comme une île [...] A partir du moment où on veut montrer que ce n'est pas une île, il va falloir vraiment le prouver. A partir du moment où c'est sur la carte, cela fait autorité.
D. Barba : Les erreurs sont un point important de votre discipline, la géographie ?
Christian Grataloup : Il y a des erreurs, mais il y a aussi des mensonges. L'Union soviétique en a énormément produits. Mais elle n'est pas la seule. Pendant longtemps l'Ile longue, base militaire des sous-marins français dans la rade de Brest, était une île toute blanche où il n'y avait strictement aucune topographie, aucune indication pour des raisons de sécurité. Il y a aussi des erreurs logiques. La Basse-Californie en fait partie.[...] La plus belle erreur, c'est l'énorme continent antarctique qu'on a dessiné sur les cartes pendant longtemps parce qu'on pensait, comme dans un culbuto, que c'était le contrepoids pour que la Terre reste axée [...].
Pour compléter
Extrait :
« Autre avantage de la carte de papier sur le GPS : elle ne fonctionne pas à pile et donc ne tombe jamais en panne. François Damien collectionne les anecdotes de voyageurs qui ont frôlé la mort parce que leur GPS a cessé de fonctionner, ou d’aviateurs amateurs qui avaient omis d’apporter une carte en papier, alors que la loi l’exige, et dont les tablettes électroniques sont tombées en panne sous l’effet de la chaleur.
Une étude britannique, publiée dans la revue Nature Communications en 2017, a déjà démontré que l’usage excessif du GPS nuit au sens de l’orientation. « On a une représentation de la terre dans notre tête. Si on est toujours en train de se faire dire de tourner à gauche ou à droite, on n’est pas en train de naviguer sur cette représentation qu’on a dans la tête, constate Louis Gobeil. On devient comme des enfants qu’il faut tenir par la main. »
Aussi, les GPS courants, ceux que l’on retrouve notamment sur les téléphones intelligents, donnent généralement le plus court chemin entre deux points, ce qui exclut de ce fait les routes plus longues mais plus pittoresques. « Parfois, on sait qu’il y a un autre chemin, mais on ne le voit pas sur l’écran du GPS. Pour faire de la villégiature, voir l’arrière-pays, bien des GPS sont pourris », constate M. Gobeil.»
Un peu curieux cette obsession de vouloir comparer la carte papier et le GPS, alors qu'ils ont tous deux des avantages respectifs... Nostalgie d'un monde d'antan ou prise de conscience des limites du (tout) numérique ?