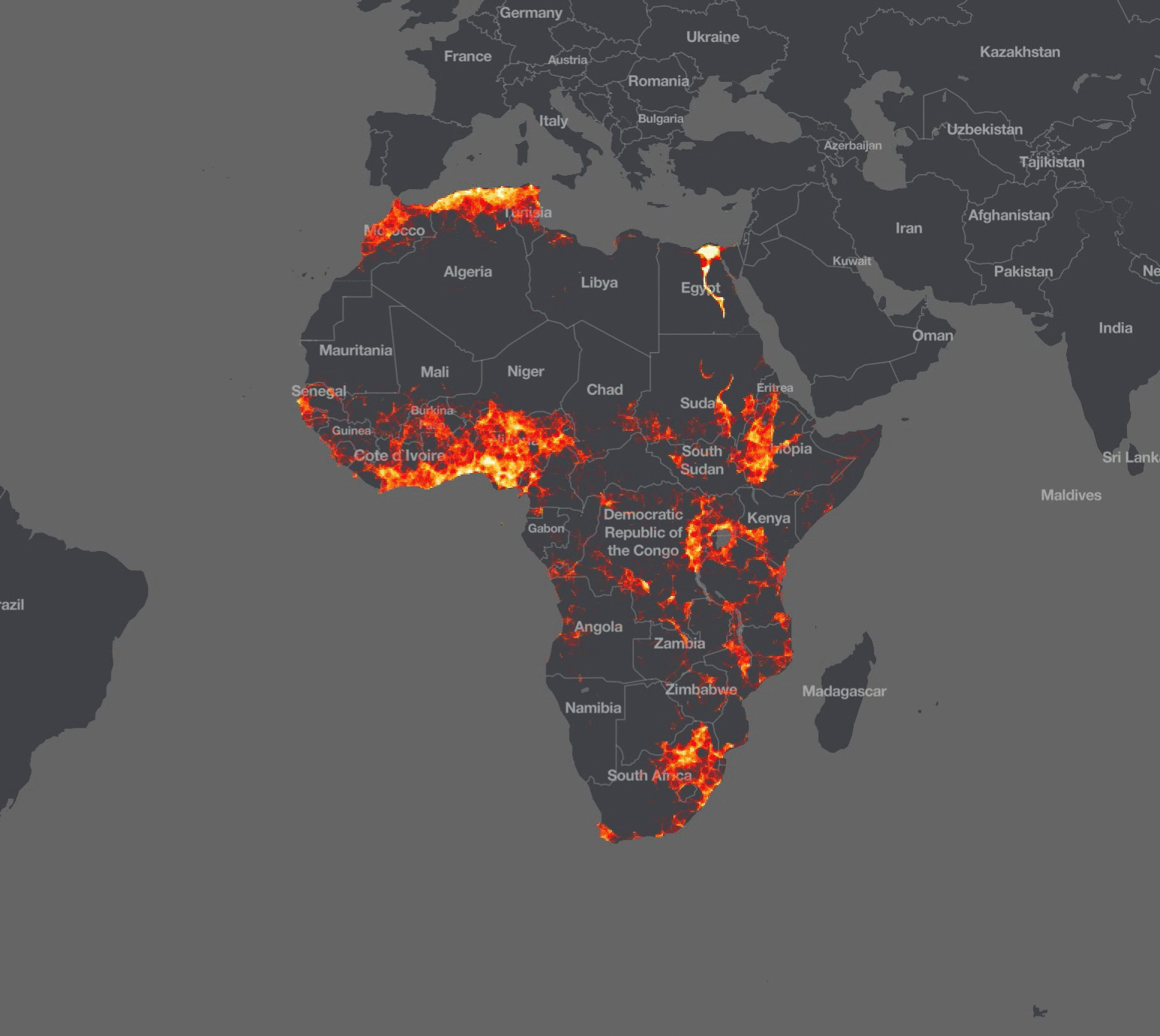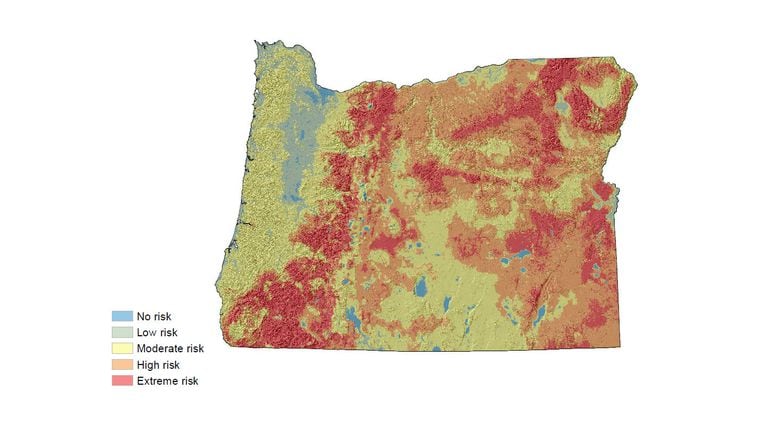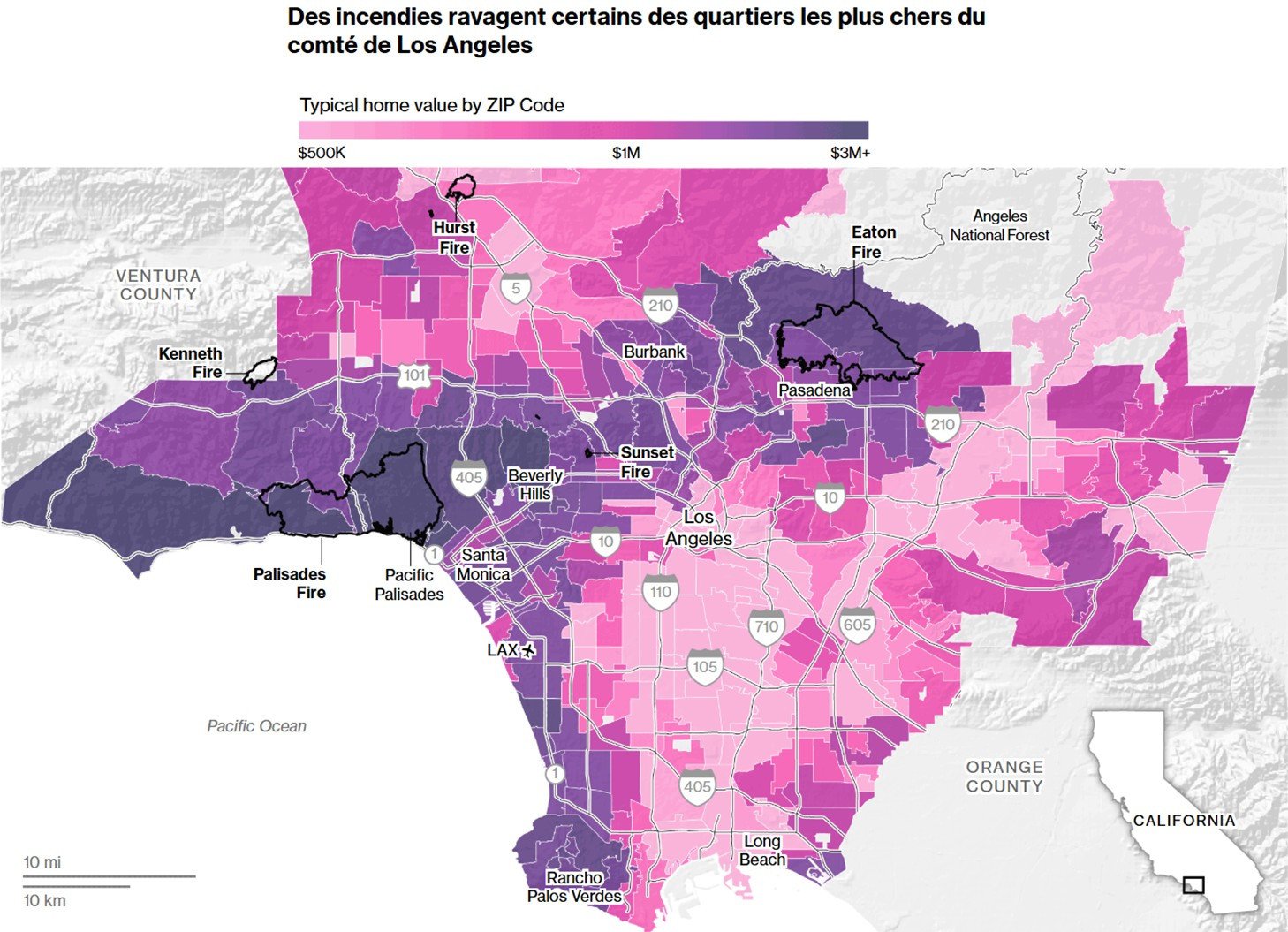Africapolis.org est un site Internet lancé le 22 novembre 2018 dans le cadre du huitième sommet Africités à Marrackech. Il a été réalisé conjointement par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) de l’OCDE et l’institut e-Geopolis. L'objectif est de cartographier au plus près le phénomène urbain en Afrique où la population est en train de devenir à majorité urbaine.
D’ici à 2050, la population africaine sera de 2,5 milliards de personnes. Sur les 1,3 milliard supplémentaires, 900 millions vivront en ville. Ce qui signifie que les villes vont absorber 70 % de la croissance démographique. Pour Laurent Bossard, le directeur du CSAO, « la transition urbaine sera en charge de la transition démographique et cette transition se passera plus ou moins bien selon que les villes et ceux qui les gèrent en auront la capacité » (voir son interview dans Le Monde du 22 novembre 2018 où il présente en même temps l'intérêt de ce nouveau site).
Le site Africapolis vise deux objectifs principaux :
- mettre à disposition des information fiables couvrant l’ensemble des agglomérations urbaines en Afrique (aussi bien les grandes métropoles que les villes petites ou intermédiaires qui sont très nombreuses).
- définir l'urbain et pouvoir suivre les dynamiques urbaines, l'évolution des zones bâties, la densification, la transition urbaine telles qu'on peut les appréhender dans le contexte africain.
L'Afrique compte déjà 11 métropoles de plus de 5 millions d'habitants, mais près de 7 000 agglomérations de moins de 100 000 habitants. Le seuil qui a été retenu pour définir une "agglomération" est de 10 000 habitants (on sort de la notion de "ville" au sens classique pour considérer la population agglomérée).
Les données d’Africapolis reposent sur un vaste répertoire de recensements de l’habitat et de la population, de registres électoraux et d’autres sources officielles concernant la population, dont certaines remontent au début du XXe siècle. La régularité, le niveau de détail et la fiabilité de ces sources varient d’un pays à l’autre et d’une période à l’autre. Des images satellitaires et aériennes sont utilisées pour recueillir des informations sur le terrain, notamment les zones bâties et la localisation précise des foyers de peuplement. Les registres officiels de la population et les données du recensement constituent l'élément le plus important. Dans certains cas, les derniers relevés disponibles remontent à 30 ans ou plus, et souvent à plus de 10 ans. Compte tenu du rythme des dynamiques démographiques et urbaines, ces périodes sont considérables.
Africapolis, comme e-Geopolis au niveau mondial, a été conçu pour fournir une base de données standardisées et géolocalisées sur les dynamiques d'urbanisation en Afrique afin de rendre les données sur les villes africaines comparables entre pays et dans le temps. Dans cette première version du site, les données des 50 pays sont disponibles pour l'année 2015 avec la possibilité de remonter jusqu'en 1950. Africapolis comble une lacune majeure en intégrant 7 225 petites villes et villes intermédiaires de 10 000 à 300 000 habitants (dont 6 737 agglomérations de 10 000 à 100 000 habitants, où vivent 180 millions d’Africains).
Le site est disponible en français et en anglais. L'interface de consultation est relativement simple. En cliquant sur le menu "Analyses" on peut obtenir des définitions et des mises au point très pédagogiques. Le menu "Explore" permet de choisir le pays et la ville que l'on veut étudier (il faut néanmoins connaître le pays avant d'accéder à la liste des villes !).
L'accès aux informations peut également s'effectuer directement à partir de la carte interactive. En cliquant sur un pays au choix, ces contours passent en surbrillance orange et les données s'affichent en fonction de la ville sur laquelle on déplace la souris. La taille des cercles est proportionnelle à la population. Pour mieux faire ressortir la typologie proposée, ces cercles se distinguent par des couleurs différentes (ce qui donne à la carte un aspect quelque peu bariolé). L'avantage est de pouvoir faire ressortir la hiérarchie urbaine du premier coup d'oeil. Voici par exemple la hiérarchie des agglomérations au Maroc avec Casablanca au premier rang (plus de 2 millions) et Marrakech, Tanger, Rabat et Fez au second rang (entre 1 et 2 millions). Le tableau récapitulatif à droite de l'écran fournit le nombre d'agglomérations au sein des 6 rangs proposés.
En zoomant sur la carte, l'extension des périmètres bâtis apparaît à l'écran. Voici par exemple la tâche urbaine de Casablanca en rouge (plus de 2 millions d'habitants) avec ses agglomérations satellites en bleu (moins de 100 000 habitants) et en violet (entre 10 000 et 30 000 habitants). En zoomant davantage, on distingue nettement le tissu urbain avec la trame viaire.
Les agglomérations les moins connectées entre elles (diagrammes de Voronoï)
Voici une présentation du site Africapolis sous la forme d'une vidéo :
Un GIF saisissant montrant l'évolution de l'urbanisation en Afrique de l'Ouest entre 1950 et 2040. Réalisé par le SWAC ou Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO)
— Laurent Bossard (@laurent_bossard) 30 janvier 2019
Liens ajoutés le 20 mars 2019
Connected network of cities in Africa - obtained by taking the coordinates of 7,447 urban ag https://t.co/SFhVw7sXeR pic.twitter.com/q6y5hBfHvy— The Big Data Stats (@TheBigDataStats) 9 mars 2019
Among the five largest urban agglomerations in #Africa are four familiar hubs of global business, media & policy making: Cairo, Lagos, Johannesburg and Kinshasa. Africa's 3rd largest urban area with 8.5 million inhabitants - Onitsha, Nigeria is not a familiar household name. pic.twitter.com/NuuyPv6Q2F— SWAC OECD (@SWAC_OECD) September 5, 2019
Une story map très réussie sur l'urbanisation en Afrique à partir des données du site Africapolis :
Lien ajouté le 2 novembre 2019
Happy #WorldCitiesDay! Between 2012 and 2019, 767 #African cities lit up the night sky for the first time. Nighttime lights satellite image from @NOAA superimposed over map of 7600 https://t.co/0ShJocIRzn urban agglomerations. Full map ➡️➡️ https://t.co/4ekUGEQwNt🌍 #UrbanOctober pic.twitter.com/NChaF8XLCb— SWAC OECD (@SWAC_OECD) October 31, 2019
Liens ajoutés le 27 janvier 2020
LAMencartes : dix élections présidentielles en Afrique en 2020— Géoconfluences (@Geoconfluences) January 20, 2020
https://t.co/HQ6qM21z77 pic.twitter.com/ZHPx879DzT
Les villes africaines vont-elles exploser ? https://t.co/DLJeZPtE19 via @FR_Conversation— géo prospective (@GeoProspective) January 27, 2020
Liens ajoutés le 21 janvier 2021
🏙️ The pace of #urbanisation in Africa is without precedent. In the next 30 years, #Africa’s population is projected to double to 2.5 billion people & its urban areas will be home to an additional 9⃣5⃣0⃣ million people.
— OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) March 4, 2020
Are cities & governments ready? 👉 https://t.co/ZM1MItOzin pic.twitter.com/jRj6cWRhY9
Armelle Choplin et Martin Lozivit, « Mettre un quartier sur la carte : Cartographie participative et innovation numérique à Cotonou (Bénin) », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 894, 2019
http://journals.openedition.org/cybergeo/32152
This week Y8 will be exploring patterns of urbanisation in Africa and then in particular Ethiopia. First we will be using a bit of GIS! https://t.co/USfG7mmavV
— Laura Wells 🌍 (@WellsGeog) May 15, 2021
Thank you to https://t.co/cigAXRWerm and this fantastic story map! https://t.co/dwo7W8B7z6 @GISinSchools #teamgeog 🌎 pic.twitter.com/3wJB6p7Vle
Lien ajouté le 24 novembre 2021
The theme for #Day23 of the #30DayMapChallenge is #GHSL. Using the GHS Urban Centres Database and focussing on countries in Africa, I've mapped the distance between each urban centre and the nearest 20 urban centres to it. pic.twitter.com/4Wafs56PZz
— Heather Chamberlain (@HeatherCh100) November 23, 2021
Les villes d’Afrique face à leur avenir https://t.co/30t5ydTf2d via @lemondefr
— Laurent Bossard (@laurent_bossard) December 9, 2021
Lien pour accéder directement à ce rapport de l'OCDE qui comprend des données intéressantes, not. sur la scolarisation en fonction de la taille des villes en Afrique
— Sylvain Genevois (@mirbole01) April 28, 2022
"Africa’s Urbanisation Dynamics 2022. The Economic Power of Africa’s Cities"https://t.co/jtK1h1lvaQ pic.twitter.com/Ok6xJDYQDX
Lien ajouté le 8 février 2024
Mapped: Africa’s Population Density Patterns 🌍️
— Visual Capitalist (@VisualCap) February 7, 2024
📲 Want more content like this, along with daily insights from the world’s top creators? See it first on the @VoronoiApp.https://t.co/dSiKaO9T6i pic.twitter.com/2pNzrsimy7
Lien ajouté le 21 novembre 2024