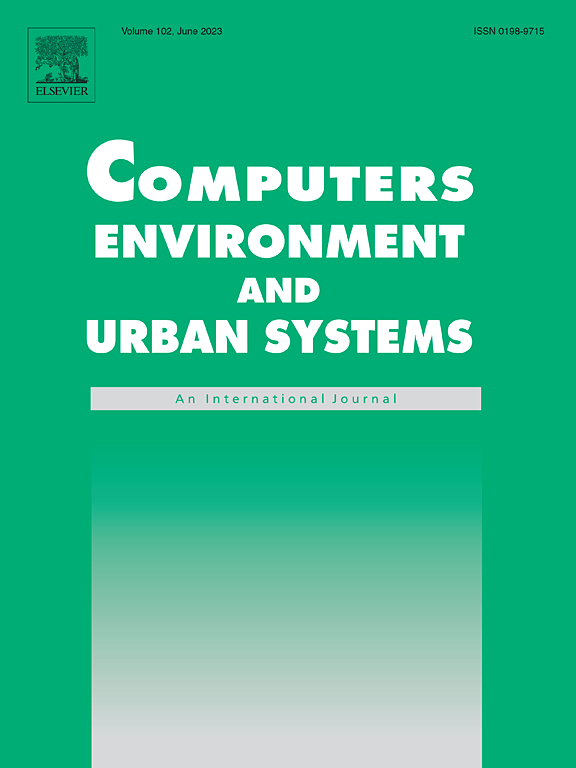Yuan Liao, Jorge Gil, Sonia Yeh, Rafael HM Pereira, Laura Alessandretti (2025). Socio-spatial segregation and human mobility : A review of empirical evidence [Ségrégation socio-spatiale et mobilité humaine : une revue des données empiriques], Computers environments and urban systems, 117, https://www.urbandemographics.org/publication/2025_ceus_segregation_and_human-mobility/
La ségrégation socio-spatiale désigne la séparation physique de différents groupes sociaux, économiques ou démographiques au sein d'un même espace géographique, entraînant souvent des inégalités d'accès aux ressources, aux services et aux opportunités. La littérature s'est traditionnellement concentrée sur la ségrégation résidentielle, examinant la répartition des lieux de résidence des individus selon différents attributs sociaux, tels que l'origine ethnique et le revenu. Cependant, cette approche néglige la complexité de la ségrégation spatiale dans les activités quotidiennes des individus, qui s'étend souvent bien au-delà des zones résidentielles. Depuis les années 2010, l'émergence de nouvelles sources de données sur la mobilité a permis une nouvelle compréhension de la ségrégation socio-spatiale en prenant en compte des activités quotidiennes telles que le travail, l'école, les courses et les loisirs. Des enquêtes traditionnelles aux trajectoires GPS, diverses sources de données révèlent que la mobilité quotidienne peut entraîner des niveaux de ségrégation spatiale différents de ceux observés pour la ségrégation résidentielle. Cette revue de la littérature se concentre sur trois questions cruciales : (a) Quels sont les points forts et les limites des recherches sur la ségrégation intégrant des données de mobilité exhaustives ? (b) Quel est le lien entre les schémas de mobilité humaine et les niveaux de ségrégation résidentielle et ceux vécus par les individus ? et (c) Quels facteurs clés expliquent la relation entre les schémas de mobilité et la ségrégation vécue ? Notre revue de la littérature améliore la compréhension de la ségrégation socio-spatiale à l'échelle individuelle et clarifie les concepts fondamentaux et les défis méthodologiques du domaine. Elle explore les études portant sur des thèmes clés : la ségrégation, l'espace d'activité, la coprésence et l'environnement bâti. En synthétisant leurs résultats, les auteurs souhaitent proposer des pistes de réflexion concrètes pour réduire la ségrégation.
La ségrégation socio-spatiale de chaque individu est souvent mesurée de deux manières : en tant que résident (ségrégation résidentielle) et en tant que visiteur ou voyageur (ségrégation vécue). Une question importante est de savoir si la ségrégation vécue est inférieure ou supérieure à la ségrégation résidentielle. La littérature révèle des résultats contradictoires, indiquant que le déplacement hors des zones résidentielles peut entraîner des niveaux de ségrégation mesurés inférieurs ou supérieurs à la ségrégation résidentielle, variant considérablement selon les individus et les groupes. Des études basées sur des données GPS ont révélé que la ségrégation ressentie est influencée par le mode de vie des individus, tel que reflété par le type de lieux fréquentés au quotidien. Les modes de vie plus axés sur la socialisation, les week-ends de shopping et les sorties au café sont associés à une meilleure intégration sociale. En revanche, les personnes fréquentant les lieux de divertissement et les restaurants peuvent présenter des niveaux de ségrégation ressentie plus élevés, car ces lieux s'adressent à des groupes de revenus spécifiques, et leur coût ou leur contexte culturel peuvent exclure les personnes à faibles revenus.
Les données montrent que les personnes résidant dans la même zone avec un logement et une accessibilité aux transports similaires peuvent avoir des niveaux de ségrégation ressentis différents en raison de la diversité de leurs exigences en matière d'activités et de leurs modes de vie. Les changements de mode de vie, tels que le télétravail, le commerce électronique, la livraison de repas, etc., peuvent influencer les niveaux de ségrégation ressentis par les individus. L'analyse de plus de 170 travaux de recherche révèle qu’une mobilité accrue permet aux individus d’être présents auprès de populations plus diverses, notamment en dehors de leurs quartiers résidentiels, offrant ainsi la possibilité de réduire le niveau de ségrégation ressentie. Les auteurs ont identifié plus de 70 études de référence utilisant des informations de géolocalisation issues de sources de données émergentes, telles que les dispositifs de localisation GPS, les GPS des téléphones portables, les enregistrements d'appels et les tweets géolocalisés, pour étudier la ségrégation socio-spatiale.
L'abondance et la complexité des mégadonnées ont stimulé le développement de méthodes et d'outils analytiques innovants dans la recherche sur la ségrégation socio-spatiale. Par exemple, la théorie de l'homophilie de mobilité, confirmée dans de multiples régions, étend sa pertinence au-delà de la ségrégation résidentielle pour inclure les schémas de ségrégation des espaces d'activité. L'exploitation de sources de données émergentes permet d'intégrer de vastes données de géolocalisation de mobilité avec des données de réseaux sociaux, dévoilant des modèles auparavant inobservables à des échelles aussi fines. Les études utilisant des sources de données émergentes, telles que les applications mobiles et les services GPS, sont confrontées à quatre défis majeurs : les biais démographiques, l’échantillonnage inégal des lieux, l’association avec les données de recensement et la méthodologie de quantification de la ségrégation socio-spatiale.
Plusieurs études soulignent la corrélation entre les niveaux de ségrégation résidentielle et vécue, attirant l'attention sur le phénomène d'homophilie de mobilité. Généralement, le niveau de ségrégation d'un individu dans son espace d'activité est inférieur à celui mesuré dans son quartier résidentiel. Cependant, ces deux aspects ne sont pas nécessairement contradictoires. Les différences de richesse induisent des schémas de mobilité distincts. Dans les pays développés, les personnes ayant un statut socio-économique élevé pratiquent souvent des activités plus diversifiées et accèdent à divers lieux, ce qui dilue leurs niveaux de ségrégation vécue. À l'inverse, les personnes à faibles revenus ont généralement une mobilité plus localisée, intensifiant leurs niveaux de ségrégation vécue. Dans les pays en développement, l'effet inverse a été observé. Les différents groupes ethniques affichent des schémas de mobilité spécifiques, gravitant souvent vers des zones majoritairement occupées par leurs communautés ou y restant.
Pour l'avenir, les auteurs préconisent trois axes de recherche essentiels, soulignant la nécessité d'une approche interdisciplinaire. Il s'agit notamment d'explorer la ségrégation vécue et de concevoir des explications spécifiques à chaque région. Premièrement, ils suggèrent que les approches spatiales d'activité alimentées par les mégadonnées géographiques soient intégrées à des sources de données supplémentaires quantifiant les systèmes de transport et les espaces urbains. Cette intégration permettrait une analyse plus complète des relations entre logement, accès aux transports, aménagement urbain et ségrégation individuelle vécue, maximisant ainsi le potentiel de l'effet d'échelle des mégadonnées. Deuxièmement, les études utilisant l'analyse de l'espace urbain pour favoriser l'intégration spatiale devraient intégrer des connaissances empiriques sur les comportements de mobilité des individus. Comme le montrent les données empiriques sur la mobilité, le défi de l'aménagement urbain pour promouvoir l'inclusion sociale pourrait résider dans la réduction de l'écart entre la coprésence intentionnelle et observée entre différents groupes de population. Troisièmement, il s'agira d'explorer les relations causales entre l'occupation du sol, les infrastructures de transport et la ségrégation vécue. L'étude de l'influence des variations des modes d'occupation du sol et des niveaux d'accessibilité sur la mobilité humaine pourrait apporter des éclairages précieux sur l'efficacité des interventions politiques visant à réduire la ségrégation socio-spatiale. Cette approche pourrait aider à identifier des stratégies pour renforcer la cohésion communautaire grâce à la planification urbaine et à la conception de politiques.
Articles connexes
Cartographier les flux de mobilité étudiante en Europe et dans le mondeÉtude des mobilités étudiantes à partir des données INSEE et Parcoursup
Étudier les mobilités résidentielles des élèves à partir des statistiques de la DEPP
Etudier les mobilités scolaires à partir des données de déplacements domicile-études de l'Insee
CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain
Le Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure
Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)
Étudier les mobilités résidentielles des jeunes Américains à partir du site Migration Patterns
Vers une loi universelle des mobilités urbaines ? (Senseable City Lab - MIT)
Quels apports du Géoweb et de la géolocalisation pour représenter les mobilités touristiques ?
Quelle évolution de la ségrégation résidentielle en France ? (France Stratégie)
Mesurer la ségrégation scolaire aux États-Unis sur les 30 dernières années (1991-2022)